Elles nous ont fait confiance
Découvrez la méthode P.M.V
Une méthode à 360° qui prend en compte toutes les spécificités de la prise de parole pour les femmes en entreprise.
Une méthode authentique
Notre méthode s'appuie sur + de 500 interviews réalisées auprès de femmes managers, cheffes de projet, ingénieures d'affaires, directrices de département ou entrepreneures. Elle est construite autour de leurs besoins et leurs contraintes. Le programme P.M.V est à la fois un moteur et un accélérateur pour la carrière des femmes en entreprise.
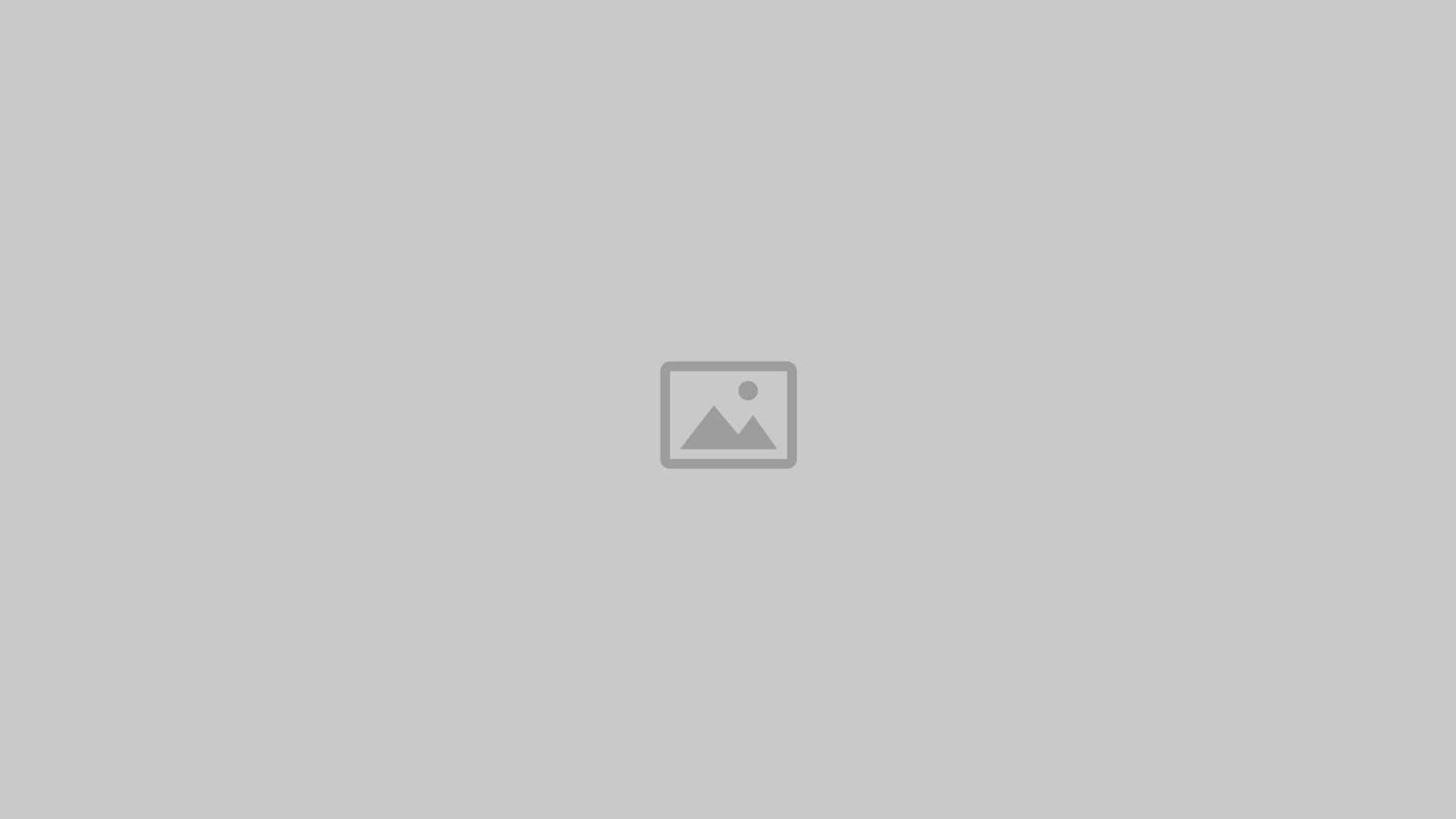
Des résultats concrets
✅ Une transformation visible dès le 1er cours
✅ Des mises en situation appliquées à la vie professionnelle
✅ Des bilans et évaluations personnalisés tout au long du parcours
Nos offres
Où nous trouver ?
Situé à deux pas du Parc Monceau, notre espace de formation est chic et cosy.
200 élèves formés
2019 à 2024 - MAJ 10/2024
5 ans d'expérience
2019 à 2024 - MAJ 10/2024
100% de réussite à la certification
2019 à 2024 - MAJ 10/2024
98% de clients satisfaits
2019 à 2024 - MAJ 10/2024
Questions fréquentes
La formation Communiquer à l'oral en situation à enjeux est certifiante et finançable avec le CPF.
Nos formations s’adressent à toutes les personnes ambitieuses (au bon sens du terme!) qui souhaitent développer leur carrière professionnelle et être reconnue à leur juste valeur. Aucun pré-requis n'est demandé.
Contactez-nous pour connaître les prochaines dates de formation et les disponibilités.
Oui. Nos formations peuvent être prises en charge par France Travail. Pour en savoir plus, prenez RDV avec notre équipe.
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. contactez-nous pour nous permettre de nous adapter. Si vous avez un autre handicap, contactez-nous, et nous ferons notre maximum pour adapter la formation à votre cas.
Oui. Nous sommes Organisme de formation certifié Qualiopi et à ce titre, nos formations peuvent être financées par votre entreprise. Contactez-nous pour en savoir plus.
Nos formations ont lieu en présentiel. A Paris, à 2 pas du Parc Monceau (17è). A 5 min. du métro,. Notre espace de formation est climatisé.
C'est un montant obligatoire à payer lorsque vous financer une formation avec le CPF. Il a été lancé en 2024 à 100€. Depuis, Il est réévalué chaque année. Ce montant est à payer directement sur le compte CPF. Certaines personnes bénéficient d'une exonération de reste-à-charge. Cliquez ici pour en savoir plus.